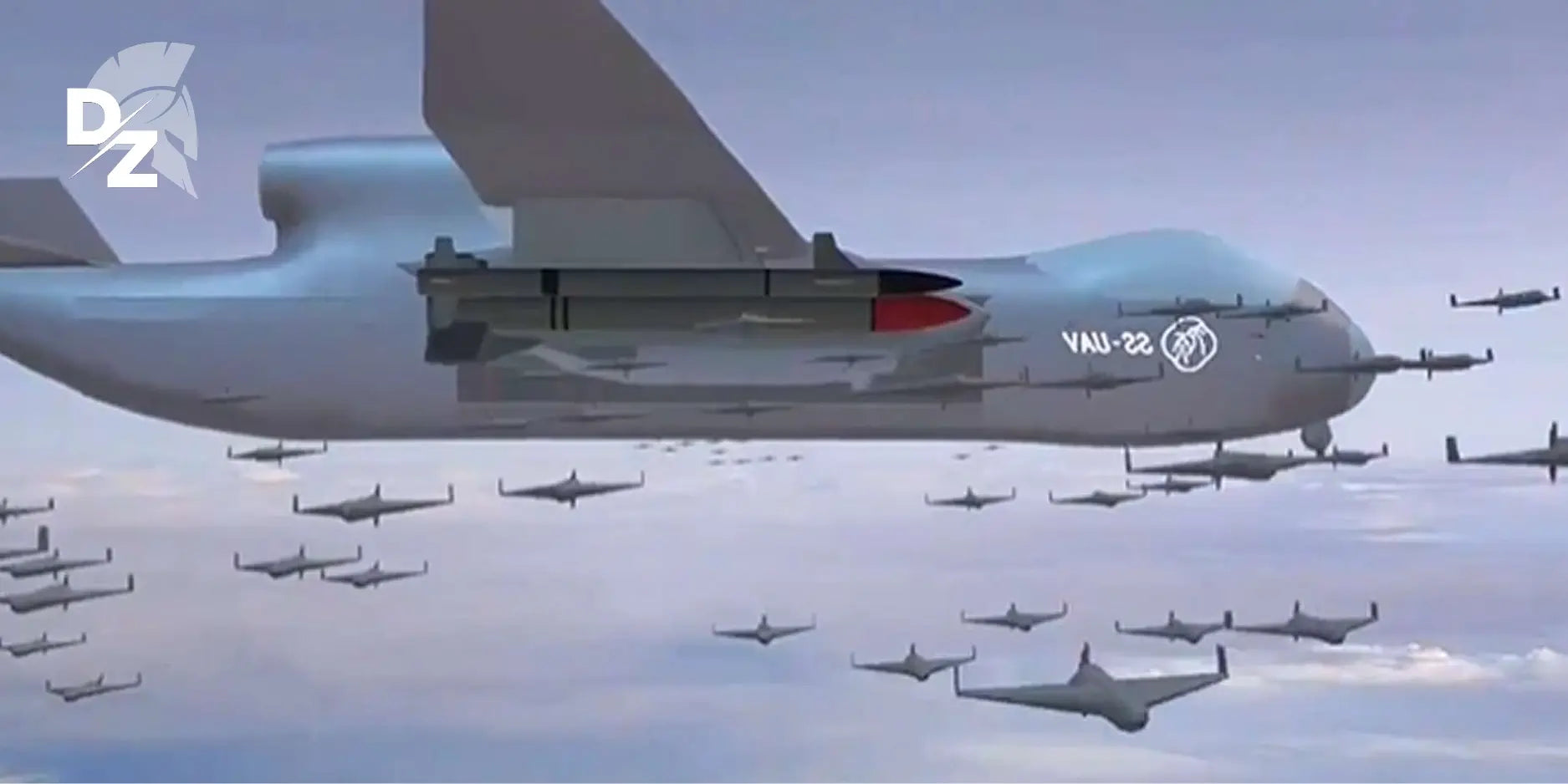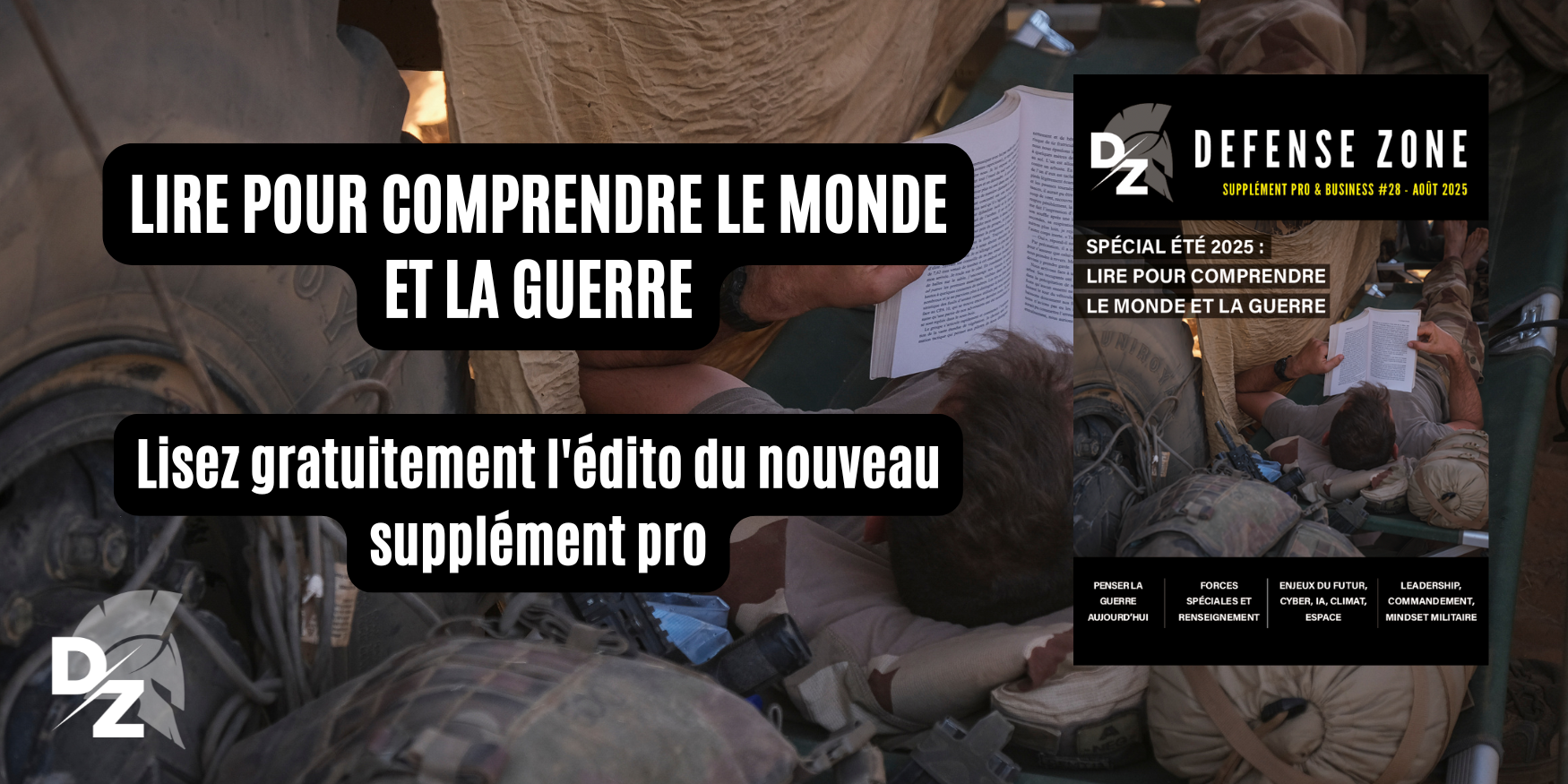Chaque année, des milliers de vies humaines sont sauvées en mer grâce à l’engagement de sauveteurs bénévoles et professionnels. Le sauvetage en mer en France est une mission complexe avec beaucoup d’acteurs institutionnels et associatifs différents, confrontés à des défis croissants liés aux conditions météorologiques, aux différentes interventions en mer et sur la plage.
Texte : Tom Serrano (Collectif DR)
Il est 10h30, l’air chaud est déjà présent sur les côtes de la mer Méditerranée dans le sud de la France. Les plages de sable jaune s’étendent sur des kilomètres et des silhouettes d’hommes et de femmes, habillés de tenues jaune et orange se découvrent au loin. Le bruit des vagues qui s’échouent sur la plage offre à ces premiers arrivants une atmosphère indescriptible. Ces hommes et ces femmes sont les sauveteurs, les gardiens des plages. Chaque matin, qu’ils soient bénévoles ou professionnels, ils se préparent à intervenir pour assurer la sécurité des baigneurs et des plaisanciers. Leur engagement est essentiel pour prévenir les accidents et sauver des vies.
En France, le sauvetage en mer repose sur une collaboration étroite entre les sauveteurs bénévoles, principalement regroupés au sein de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM), et des professionnels issus de la Marine nationale, de la Sécurité civile, de la Gendarmerie maritime et des sapeurs-pompiers. Bien que partageant un objectif commun – sauver des vies – ces acteurs se distinguent par leur statut, leur mode d’organisation, leurs missions spécifiques et leurs moyens d’actions...